Je construis des alliances · Parents
Je construis des alliancesParents
Je rencontre les parents afin d’établir un dialogue centré sur les besoins de développement de leur enfant
Assurer la sécurité
Ne jamais discuter de vos doutes de violence conjugale en présence des deux parents. La sécurité du parent qui subit la violence conjugale ainsi que celle de l’enfant pourrait être menacée.
Éviter d’être instrumentalisé(e) par l’auteur de la violence conjugale contre l’enfant et le parent qui la subit. Il est important de se centrer sur les besoins de l’enfant et sur vos observations. Ce parent pourrait tenter d’influencer votre perception, de mentir, de provoquer des conflits ou de recourir à la manipulation, ce qui isolerait davantage le parent qui subit la violence conjugale ainsi que l’enfant.
Éviter de recommander une rupture de la relation.

Cette rencontre peut faire apparaître d’autres indicateurs de violence conjugale et rendre plus visibles les signes déjà présents.
L’importance de créer un lien avec les deux parents dès le départ, soit lors de l’inscription de l’enfant, permet de mieux les connaître et de mieux percevoir les changements dans leurs comportements en cours de route.
Les signes précédemment observés chez l’enfant et les parents peuvent être :
- D’autres éléments semblent expliquer les observations.
- Maintenir la vigilance.
- Prévoir une rencontre supplémentaire avec le ou les parents au sujet des besoins de développement.
- Poursuivre l’observation de la situation familiale à l’aide des outils de la trousse FÉE.
- Apprécier la dangerosité.
- Réaliser un suivi des conséquences de l’exposition de l’enfant à la violence conjugale et des signes de la violence conjugale chez les parents.
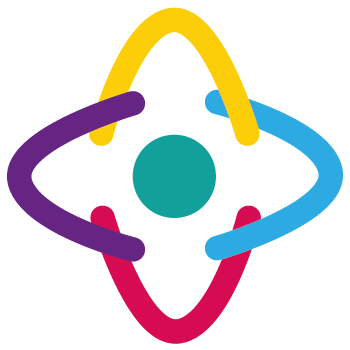
Manifester une préoccupation à l’égard du bien-être de l’enfant afin de tisser des liens de confiance avec chacun des parents.
Utiliser les ressources de votre service de garde éducatif à l'enfance afin d’aborder les préoccupations et les forces de l’enfant (ex. : portrait éducatif, PAPFC-Cadre d’analyse écosystémique, Carrick, grille de développement).
Éviter de catégoriser l’enfant (ex. : « Marine est agressive actuellement. »).
- « Depuis quelques semaines, il y a des choses qui me préoccupent au sujet de votre enfant. Ça m’amène à me poser la question suivante : comment peut-on comprendre ces comportements? »
- « En tant qu’éducatrice, éducateur ou RSGE qui prend soin de votre enfant, j’ai un souci, une préoccupation. »
- « J’ai pris davantage de temps avec votre enfant dernièrement, car certaines choses me préoccupent. »
- « Avez-vous remarqué si votre enfant agit de la même façon à la maison? »
Si le parent auteur de violence conjugale s’adresse au service de garde éducatif à l'enfance en évoquant la violence conjugale
L’éducatrice, l’éducateur ou le (la) RSGE devient alors témoin des verbalisations ou des aveux du parent auteur de violence conjugale.
Garder en tête les éléments suivants :
- La protection de l’enfant exposé à la violence conjugale et du parent qui la subit est toujours à prioriser.
- Demeurez vigilant(e) à ne pas transmettre d’informations à propos du parent qui subit la violence conjugale.
- La motivation première des parents auteurs de violence conjugale est souvent le désir de s’améliorer pour leur enfant.
- Se centrer sur les besoins des tout-petits permet souvent de diminuer la tension. Sensibiliser le parent aux impacts de l’exposition à la violence conjugale chez son enfant.
- Diriger le parent vers des ressources, dont les organismes spécialisés pour les auteurs de comportements violents. Le référencement est important dans la lutte à la violence conjugale.
Le personnel éducateur et le (la) RSGE doivent s’en remettre aux ordonnances du tribunal en matière de contact parent-enfant. En cas de doute majeur sur la sécurité d’un enfant ou du non-respect d’une ordonnance, le service de garde éducatif à l'enfance doit contacter les services d’urgence et faire un signalement au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
Référence : Ministère de la Famille (www.mfa.gouv.qc.ca)
Je rencontre le parent victime ou potentiellement victime de violence conjugale
Cette démarche est primordiale et peut permettre une prise de conscience chez le parent.
Assurer la sécurité
Éviter de remettre aux parents des documents liés à la Trousse FÉE.
Appliquer les attitudes et comportements appropriés auprès d’un parent
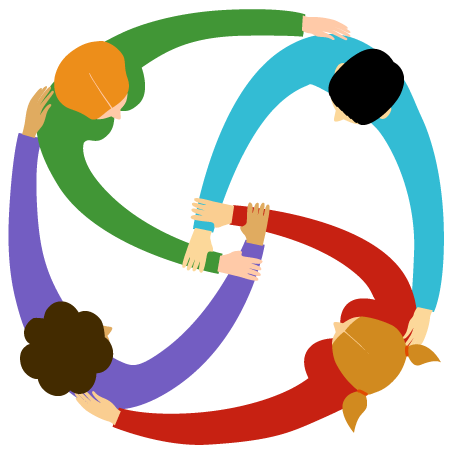
Repères clés des attitudes et comportements appropriés dans la communication avec un parent qui subit de la violence conjugale.
En construisant des cercles de bienveillance autour du parent qui subit de la violence conjugale, vous favorisez la sécurité physique et psychologique du tout-petit.
Comprendre et identifier les résistances du parent
Normaliser le vécu émotif du parent
Comprendre et explorer les peurs du parent
Démontrer du soutien envers le parent
Laisser au parent le libre pouvoir d’agir
Prenez position contre la violence
Soutenir la reconnaissance de la problématique de la violence
Poser des questions ouvertes
Tenir compte des spécificités des hommes qui subissent de la violence conjugale
Les pères qui subissent de la violence conjugale sont plus difficiles à identifier, car ils gardent davantage le silence, vont rarement consultés et sont portés à banaliser les conséquences de la violence subie. Ils se heurtent aussi à des préjugés sexistes et à des services qu’ils tendent à percevoir comme inadaptés à leur réalité.
Les attitudes à adopter lors de l’intervention auprès de ceux-ci doivent tenir compte :
- du sentiment de culpabilité, d’échec et d’humiliation;
- de la crainte d’être ridiculisé par leur entourage et les services;
- de la peur d’être soupçonnés à tort d’être les auteurs de la violence;
- du refus d’être identifiés comme des « victimes »; la société représentant encore les hommes comme forts et devant cacher leurs vulnérabilités;
- du sentiment de solitude et d’isolement.
Éviter de…
Face à un parent qui subit de la violence dans son couple, plusieurs attitudes sont répandues, mais un bon nombre d’entre elles sont à éviter. Ces attitudes sont nuisibles et peuvent faire augmenter la pression ressentie par ce parent.
- Éviter de porter des jugements : « Vous êtes bien patiente. », « Moi, à votre place… »
- Éviter de minimiser, ridiculiser, cautionner ou banaliser la violence vécue par l’enfant et le parent, peu importe le type de violence et les circonstances : « Laisse-le faire. ». L’auteur est responsable de ses comportements violents.
- Éviter de les inciter à comprendre les gestes de violence : « C’est vrai qu’il en a bavé dans son enfance et il ne peut pas faire autrement que de reproduire ça avec vous. »
- Éviter de les encourager à demeurer avec le ou la partenaire violent(e) : « Pensez-y à deux fois avant de le quitter, c’est difficile et compliqué, une séparation. »
- Éviter de décider les choses à sa place : « Je vous emmène dans une maison d’hébergement. »
- Éviter de vous positionner en recommandant une rupture de la relation : « Vous devriez vraiment le quitter, ça n’a aucun bon sens. »
Le parent ne doit pas sentir de pression quant au fait de quitter son ou sa partenaire. Le risque d’un passage à l’acte violent est accentué lors de la rupture, particulièrement lorsqu’une mère quitte son conjoint auteur de violence conjugale. Il est fortement conseillé que le parent consulte des ressources d’aide (SOS violence conjugale, maison d’hébergement, centres de santé et de services sociaux) afin de préparer son départ, par exemple à l’aide d’un scénario de protection.
- Éviter de renforcer le sentiment de culpabilité : « Qu’est-ce ce que vous avez pu faire pour le mettre dans cet état? ».
- Éviter de faire des promesses impossibles à tenir. Vous avez l’obligation de faire un signalement si vous avez des doutes quant à la sécurité ou au développement de l’enfant, et ce, même si le parent vous demande de garder le secret. Le parent doit poser des gestes qui protègent son enfant.
- Éviter de vous laisser submerger par vos propres émotions, par exemple en manifestant de la colère à l’endroit de l’auteur de comportements violents. Vous devez démontrer un positionnement ferme face aux comportements violents, mais sans être envahi(e)s par vos propres émotions.
- Éviter d’aborder la violence conjugale devant le parent auteur ou de faire parvenir de l’information, de quelque façon que ce soit, concernant la violence conjugale sans en avoir reçu la demande.
- Éviter d’être instrumentalisé(e)s contre l’enfant et le parent qui subit la violence conjugale par celui qui en est l’auteur. Ce parent pourrait tenter d’influencer votre perception, d’utiliser la manipulation et les mensonges, de provoquer des conflits ou d’avoir recours à la manipulation, ce qui aurait pour conséquence d’isoler davantage le parent qui subit la violence conjugale ainsi que son enfant. Il est important de demeurer centré sur les besoins de l’enfant et sur vos observations.
- Éviter de recommander le recours à la thérapie conjugale et familiale.
Mise en situation : la famille de Marine
Marine, 4 ans
Présentation
Famille : mère (Isabelle), beau-père (Marc), frère (Louis, 12 ans), père de Marine et Louis (Steve), demi-frère (Thomas, 3 ans)
Isabelle est âgée de 31 ans. Elle donne naissance à Louis alors qu’elle a 19 ans. Elle est alors en couple avec Steve, son premier amoureux du secondaire. Isabelle désire agrandir sa famille, mais elle n’arrive pas à devenir enceinte aussi rapidement que pour son premier enfant. La venue au monde de Marine a pour effet d’augmenter les propos et les comportements violents de Steve (dénigrer, lancer des objets, frapper, faire pression pour des relations sexuelles non consenties). Isabelle se sépare de ce dernier alors que Marine est âgée d’un an. Steve est peu impliqué dans la vie de Louis et de Marine. C’est Isabelle qui s’occupe des enfants à temps complet.
Isabelle rencontre ensuite Marc. Elle apprécie tout de suite sa façon d’interagir chaleureusement avec Louis et Marine. Elle tombe alors enceinte de Thomas, rapidement et de façon inattendue.
Mise en situation : la famille d’Adila
Adila, 2 ans et demi
Présentation
Famille : mère (Fatima), père (Youssef), frère (Amir, 1 an)
Les parents ont immigré au Canada il y a deux ans et demi. Ils ont vécu dans un pays du Moyen-Orient jusqu’à ce qu’une guerre civile éclate. Ils se sont alors dirigés dans un camp de réfugiés, avant d’immigrer au Canada.
Dans leur pays d’origine, le père exerçait la profession de dentiste et la mère occupait un emploi en génie. Depuis leur arrivée au Canada, ils ne réussissent pas à obtenir une reconnaissance de leurs compétences. Le père effectue de la livraison de marchandises et la mère occupe un poste de conseillère dans une compagnie d’assurance. Elle termine bientôt son congé parental avec Amir. Celui-ci doit intégrer le milieu familial de Yasmine au début de la prochaine année scolaire.
Aborder avec le parent les préoccupations qui concernent l’enfant
Ces interventions peuvent permettre de sensibiliser le parent qui subit la violence conjugale aux conséquences de celle-ci sur le développement de son enfant.
Utiliser l’outil de détection afin de soutenir le dialogue entourant les impacts observés chez l’enfant.
Utiliser d’autres repères de la Trousse FÉE (ex. : types et cycle de la violence conjugale, formes d’exposition à la violence conjugale).
Aider le parent qui subit la violence conjugale à assurer sa sécurité physique et psychologique ainsi que celle de son enfant.
- Utiliser l’Aide-mémoire des signes de violence conjugale et la Grille d’appréciation de la dangerosité.
- Au besoin, adresser vos inquiétudes au parent victime de violence conjugale. À savoir : il ne faut pas avoir peur de poser des questions précises sur le contexte entourant la violence conjugale. Par exemple :
- « Est-ce que vous vivez de la peur dans votre relation actuellement? »
- « Est-ce que vous vous sentez contraint(e) d’agir d’une certaine façon dans votre relation? »
- « Est-ce que vous avez peur des représailles? »
Grille d’appréciation de la dangerosité en matière d’exposition à la violence conjugale
Le rôle des éducatrices et des éducateurs envers les parents
« Lorsque les services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) accueillent les jeunes enfants, ils accueillent également leur mère, leur père et leurs grands-parents ou les membres de la famille élargie, qui jouent parfois un rôle central dans leur éducation. Ces personnes sont celles qui ont le plus d’importance pour le jeune enfant » (Gouvernement du Québec/MFA, 2019).
« Les témoins s’entendent : pour aider un enfant, il faut aussi aider son parent » (CSDEPJ, 2021).
Une réflexion concernant les besoins des enfants permet de favoriser ce partenariat et de remplir un rôle de prévention face aux situations familiales où la violence conjugale pourrait s’installer.
Les parents qui commettent des actes de violence conjugale et ceux qui les subissent continuent d’être des parents et d’avoir une responsabilité à l’égard de leurs enfants.
Il existe des ressources accessibles sur une base volontaire. Votre rôle consiste à évaluer l’opportunité de sensibiliser les parents à utiliser ces ressources grâce à diverses stratégies visant à assurer une communication efficace, à établir un partenariat et à solliciter leur participation. Dans plusieurs situations, le fait de compléter une référence peut s’avérer favorable.
Par ailleurs, le tribunal peut recommander que le parent s’implique dans différents services au moyen d’une ordonnance en protection de la jeunesse, mais même alors, le parent n’est pas obligé de le faire. Évidemment, si tel est le cas, le tribunal prendra les mesures qui s’imposent. Par exemple, si le tribunal recommande à un père de consulter une ressource pour hommes ayant des comportements violents, mais que ce dernier ne reconnait pas qu’il adopte des comportements violents et refuse de consulter, la garde de l’enfant pourrait lui être retirée.

Évidemment, l’ensemble de votre rôle — tant l’observation, l’intervention que la construction d’alliances — contribue à la prévention des situations de violence conjugale en aidant les parents à placer au centre de leurs préoccupations les impacts de leurs décisions et de leurs gestes sur leur enfant. Également, l’enfant lui-même représente un levier important de prévention de la violence conjugale.
Les services de garde éducatifs à l'enfance poursuivent leur engagement par leur travail quotidien auprès des enfants et de leurs familles et en adoptant les meilleures pratiques en matière de violence conjugale. Ces meilleures pratiques sont transmises dans la Trousse FÉE afin de vous permettre de continuer à jouer ce rôle si important, et ce, en dépit du contexte d’adversité.
Le contexte particulier de la violence conjugale : la relation intime
L’aspect bien particulier de la violence conjugale est qu’elle survient à l’intérieur d’une relation affective et intime.
Être dans la relation, c’est différent que d’être à l’extérieur de celle-ci.
Être à l’extérieur, c’est voir les comportements violents et les impacts d’une façon qui est bien différente de celle des membres de la famille qui évoluent ensemble dans ces relations.
Le parent victime de violence perçoit que sa relation conjugale est sécurisante ou qu’elle peut l’être. Il s’agit d’un moteur important pour une telle relation. Au départ, le parent a décelé les aspects positifs et des avantages de cette relation. C’est ce qui l’amène à poursuivre la relation lors de la lune de miel. Le parent perçoit qu’il subira des pertes importantes en quittant cette relation.
Le parent a déjà connu son partenaire sous un jour meilleur. Cela nourrit son espoir tout au long de la relation et contribue au maintien de celle-ci. Ce lien peut alimenter la violence, lorsque le parent auteur de comportements violents évoque qu’il est en droit de s’imposer et de contrôler son partenaire et son enfant.
Qu’est-ce que je gagne en demeurant dans cette relation? Que vais-je perdre si je me sépare?
Les stéréotypes, à l’inverse de l’égalité
« L’égalité désigne l’égalité des droits, des responsabilités et des chances des femmes et des hommes, des filles et des garçons. Égalité ne veut pas dire que les femmes et les hommes doivent devenir les mêmes, mais que leurs droits, responsabilités et opportunités ne dépendront pas du fait qu’ils sont nés hommes ou femmes. » (Gouvernement du Québec/SCF, 2021).
La violence conjugale se situe à l’opposé de l’égalité. Elle constitue une prise de contrôle d’une personne envers l’autre. Les stéréotypes basés sur le genre contribuent à la violence conjugale. Il est possible de reconnaitre les stéréotypes par certaines formulations traduisant la totalisation d’un genre. Par exemple : « Les filles sont… », « Les garçons veulent… », « Les femmes vont… », « Les hommes ne font pas… ».
« Les stéréotypes imposent des limites à la personne qu’ils visent, l’enferment dans un rôle qui ne lui convient pas nécessairement et l’empêchent d’être qui elle est réellement. » (Gouvernement du Québec). Les stéréotypes sexuels font en sorte que les hommes et les femmes sont associés à des univers distincts.
Le rôle des services de garde éducatifs à l'enfance en matière d’égalité entre tous les enfants, et ce, peu importe leur genre, se révèle crucial afin de s’attaquer aux stéréotypes qui contribuent au maintien de la violence conjugale.
Il est facile d’affirmer que nous combattons les stéréotypes de genre, mais à quel niveau se situe notre engagement au quotidien?
Peu importe le genre...
- Est-ce que vos attentes sont les mêmes quant à l’expression des sentiments ou à l’empathie?
- Est-ce que vous favorisez l’apprentissage à prendre soin des plus petits chez tous les enfants?
- Est-ce que vous et votre partenaire vous occupez conjointement des responsabilités familiales (ex. : gérer l’agenda familial, cuisiner, faire les devoirs, etc.)?
- Est-ce que vous accueillez de la même façon tous les enfants (ex. : câlins, d’une manière énergique et dynamique, etc.)?
- Est-ce que les mêmes tâches sont attribuées à chacun des enfants?
